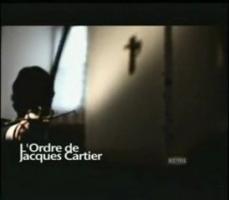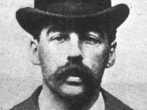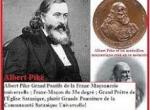L'Ordre de Jacques Cartier
par damino - 2735 vues - 0 com.
L'Ordre de Jacques Cartier
Les francophones défavorisés
Au début du 20ème siècle, les Catholiques francophones au Canada ont beaucoup de difficulté à obtenir des services en Français et acceptent mal de voir Rome nommer des évêques anglophones d’origine irlandaise dans presque tous les diocèses du Québec et de l’Ontario, sans parler du reste du pays. La situation est particulièrement frustrante pour les Canadiens Français de l’Ontario, heurtés par le Règlement 17 émis par le premier ministre Ontarien James Whitney, et qui limite à une heure par jour l’utilisation du Français à l’école. Dans la fonction publique, à Ottawa, les francophones ont aussi plus de difficultés que leurs collègues anglophones à obtenir des promotions. C’est dans ce contexte que l’ingénieur civil Albert Ménard, francophone et fonctionnaire au gouvernement fédéral, rencontre l’Abbé François-Xavier Barrette de la paroisse Saint-Charles d’Ottawa.
S’approprier les tactiques de l’ennemi
Les deux hommes discutent entre autres de l’influence des sociétés dites secrètes comme les Orangistes, les Francs-Maçons et la Chevaliers de Colomb – largement composées d’anglophones protestants à l’époque– sur les nominations religieuses et politiques. L’Abbé Barrette convainc Albert Ménard de la nécessité de fonder une organisation s’apparentant à la Franc-Maçonnerie, et qui utiliserait les mêmes stratégies aux tactiques camouflées afin d’assurer la survie du groupe ethnique canadien français et lui garantir un meilleur accès aux postes de pouvoir.
Ils réunissent donc une poignées d’hommes dont ils connaissent les valeurs patriotiques, et tiennent une première réunion de la société secrète des Commandeurs de l’Ordre de Jacques-Cartier le 22 octobre 1926. Très peu de temps après, on confie à Émile Lavoie la tâche d’élaborer un rituel d’initiation calqué sur les rituels Franc-Maçonniques. L’Ordre est divisé en deux corps distincts : la Chancellerie, soit le conseil supérieur qui détient l’autorité suprême, et la Commanderie, qui s’occupe du recrutement et des réunions sur le terrain.
Noyautage, infiltration
Les membres de l’Ordre de Jacques-Cartier sont recrutés très discrètement parmi les meilleures classes de la société. On cherche avant tout des membres qui sauront être influents dans leur milieu immédiat, dans le secteur public ou privé. L’Ordre infiltre aussi plusieurs associations (comités de parents, syndicats, associations de jeunes, coopératives d’épargne et de crédit) en y recrutant des membres ou en y faisant entrer des personnes clés, ce que les membres appellent le « noyautage ». Rapidement, des centaines de commanderies sont crées en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et dans l’Ouest Canadien.
Discrétion absolue
La discrétion est excessivement importante pour l’Ordre, et les commanderies se réunissent dans des lieux très banals, comme des sous-sols d’église ou des locaux universitaires, afin de ne pas attirer l’attention. Pour entrer dans les réunions, les membres doivent connaître un mot de passe, qui peut changer de fois en fois. Les femmes ne sont pas admises dans l’organisation. La Chancellerie communique ses directives aux commanderies par l’entremise de l’Émérillon, une publication mensuelle distribuée à tous les membres et nommée en l’honneur de l’un des navires de Jacques-Cartier. Afin de ne pas éveiller les soupçons lorsqu’ils parlent de l’Ordre entre eux en public ou devant leurs épouses, les membres parlent de « La Patente », un mot fourre-tout qui ne laisse rien deviner. Lors des quelques rencontres officielles et congrès tenus dans des hôtels, l’Ordre utilise des faux noms pour éviter d’être repéré par les médias.
Une influence énorme
Tout au long des années 1930, l’influence de l’Ordre se fait sentir à travers de nombreuses campagnes d’envoi massif de cartes postales ou de lettres par les membres. Ceux-ci réclament et obtiennent par exemple : le bilinguisme sur la monnaie canadienne et les formulaires d’assurance-chômage, des émissions de radio en Français diffusées à Radio-Canada d’Halifax aux Rocheuses, des services en Français dans les compagnies d’utilité publique (chez Bell Canada, entre autres), ainsi que de nombreuses nominations d’ecclésiastiques francophones dans des écoles et des paroisses à travers le pays. L’Ordre crée aussi la Ligue d’achat chez nous, qui favorise l’achat local et permet à de nombreux commerçants de survivre à la crise économique du début des années 1930. Au Québec, de nombreux membres de la Société Saint-Jean-Baptiste sont aussi membres de l’OJC.
Après la Deuxième Guerre Mondiale (1939-1945), les membres de l’OJC travaillent en sous-main pour obtenir la francisation de la toponymie du Québec (Three Rivers devient par exemple Trois-Rivières) et jouent un rôle important dans la création d’un drapeau pour le Canada et pour le Québec, en plus d’imposer un nouvel hymne national, Ô Canada, qui remplace le God Save The Queen Brittannique.
En 1943, l’Ordre fonde la Société Richelieu, un club social francophone, équivalent du Rotary Club, qui sert de paravent à la fraternité tout en permettant de diffuser plus largement ses idées. Malgré sa grande influence, l’Ordre exige toutefois que ses membres qui souhaitent se lancer en politique active quittent l’organisation en demandant une suspension à la Chancellerie.
Le début de la fin
Au début des années 1960, des dissensions surviennent entre les membres du Québec, qui souhaitent davantage d’indépendance, et ceux des autres provinces. Charles-Henri Dubé, un ancien membre, révèle en 1963 les secrets de l’Ordre au magazine Maclean’s, et affirme que La Patente est un frein à la démocratie au Québec, entrainant d’autres défections. En 1965, la Chancellerie du Québec affronte les Chanceliers de l’Ontario, de l’Acadie et de l’Ouest au congrès national, et revendique toujours plus de pouvoirs pour le Québec en raison de sa plus forte proportion de membres au pays. Les autres chancelleries ne sont pas d’accord avec le mouvement indépendantiste québécois et votent plutôt pour la dissolution de l’Ordre. Un communiqué est envoyé le 3 mars 1965 pour annoncer la nouvelle à tous les membres. « Les administrateurs de cette société ont décrété sa dissolution en raison de l’existence et de la puissance de nombreuses structures sociales, économiques et nationales au Canada français et parce que, selon eux, l’Ordre a accompli sa mission. Stop. », peut-on lire dans le télégramme.
Les membres Ontariens auraient par la suite crée une nouvelle société secrète, baptisée les Commandeurs de l’Ordre des Franco-Ontariens, avec une structure identique à celle de l’Ordre, mais on estime qu’elle a cessé ses activités vers 1971. Les historiens estiment qu’à travers ses 40 années d’existence, l’Ordre a vu passer plus de 70 000 membres. À sa dissolution en 1965, l’organisation comptait 12 000 membres.
Source : http://lesignesecret.historiatv.com/les-societes/l-ordre-de-jacques-cartier-21.html